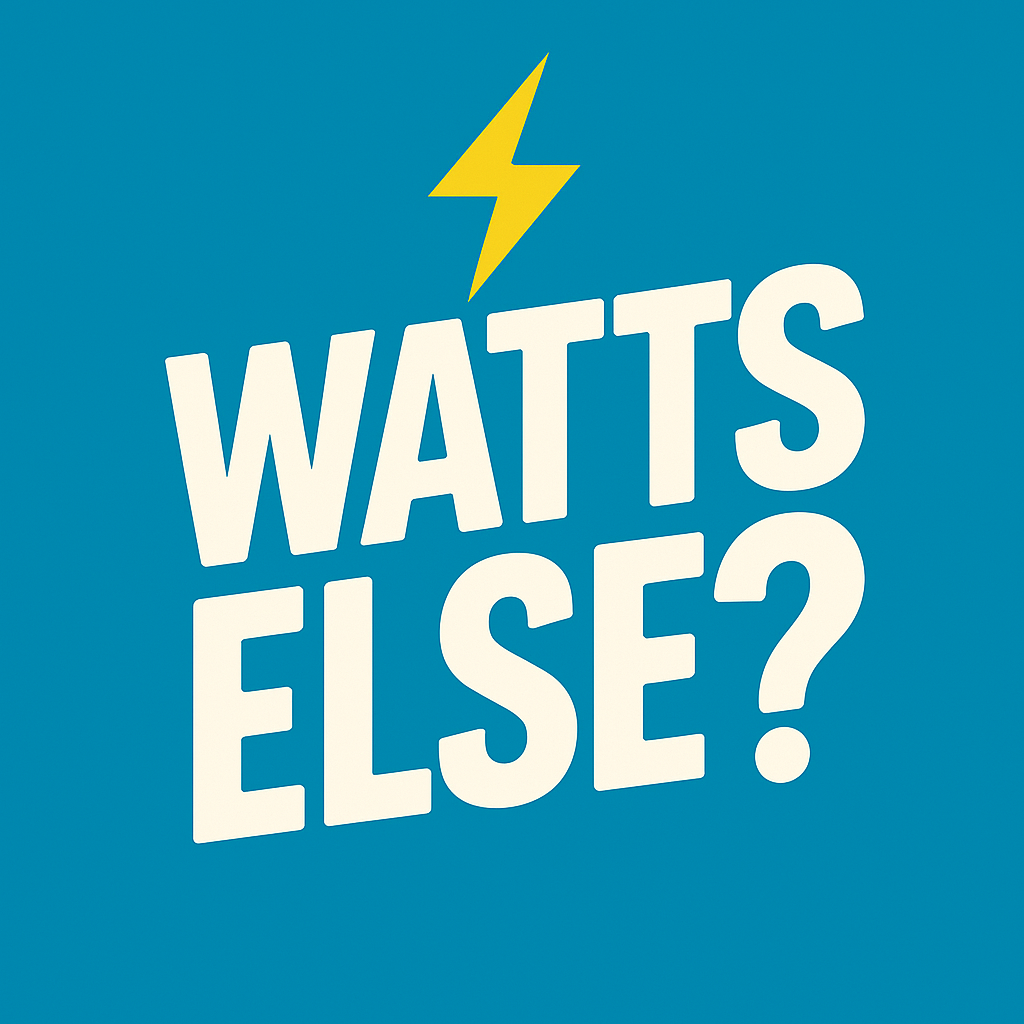Alsace-Moselle : laboratoire ou mirage de la transition énergétique ?
Sur le papier, c’est l’idylle européenne de l’énergie verte. Située au croisement des flux économiques, des réseaux gaziers et des rêves décarbonés, la région Alsace-Moselle s’affiche comme un « carrefour stratégique » pour l’hydrogène et le lithium. Infrastructure existante ? C’est fait. Coopération transfrontalière ? Active. Soutiens publics ? Massifs. Acteurs privés ? Nombreux. Mais à force de tout cocher, on finit parfois par faire trembler le sol — littéralement.
⚗️ Hydrogène : autoroute verte ou impasse thermodynamique ?
Hydrogène vert par électrolyse, mobilité lourde décarbonée, plateformes industrielles reconverties… La stratégie hydrogène du Grand Est mise sur une puissance installée de 600 MW et une production de 90 000 tonnes de H₂ par an à horizon 2030. La Commission de Régulation de l’Énergie (CRE), elle, reste prudente : le rendement global de cette filière tourne entre 20 et 30 %, bien loin des batteries (>80 %). L’ADEME, dans un rare moment de clarté technologique, recommande de réserver l’hydrogène aux usages où les batteries ne peuvent rivaliser — poids lourds, industrie lourde, process continus.
Mais la dynamique est lancée. Le projet CarlHYng à Carling prévoit une usine d’électrolyse de 300 MW portée par Verso Energy et Siemens Energy (450 M€, 51 000 tonnes/an). À Florange, ArcelorMittal accueillera un électrolyseur installé par Westfalen Group d’ici 2026 pour substituer son H₂ fossile. Et l’aciériste a lancé la gamme HyMatch® : des aciers conçus pour résister aux contraintes du transport d’hydrogène à haute pression.
GRTgaz, opérateur historique du gaz, convertit 70 à 80 km d’anciens tuyaux dans le cadre du projet MosaHYc (100 km, 117 M€), pour relier Moselle, Sarre et Luxembourg, avec un potentiel de 60 000 tonnes/an. L’objectif : éviter 895 000 tonnes de CO₂/an. Il pilote aussi Hy-Fen, un futur axe Sud-Nord national de transit H₂. Et pendant ce temps, la SNCF teste les premiers trains à hydrogène français, entre Alsace et Bade-Wurtemberg. Des stations-service H₂ émergent à Sarreguemines, Strasbourg (2026), et ailleurs.
🌋 Lithium géothermal : la mine liquide sous contrôle (ou presque)
Le fossé rhénan recèle un trésor : des saumures naturellement riches en lithium (jusqu’à 200 mg/L). Le projet EuGeLi, mené par Eramet, Électricité de Strasbourg et leurs partenaires européens, a produit en 2021 les premiers kilos de carbonate de lithium batterie-grade à partir de géothermie. Un saut technologique majeur, sans mine à ciel ouvert ni transport intercontinental — mais avec un sol qui grogne. Les séismes de Vendenheim restent dans les esprits.
L’initiative se poursuit avec AGeLi : 10 000 tonnes de lithium par an d’ici 2030, pour alimenter 250 000 batteries de véhicules électriques. La start-up Lithium de France (groupe Arverne), soutenue par le BRGM, prévoit des unités industrielles combinant extraction géothermique et fourniture de chaleur renouvelable. Le projet est ambitieux, mais reste suspendu à deux fils : la stabilité du sous-sol… et l’acceptabilité sociale.
🔋 De la matière au moteur : toute une filière en construction
À Lauterbourg, Viridian Lithium prévoit la première usine française de raffinage de lithium (28 500 t/an dès 2027, >200 M€). À Mulhouse, Blue Solutions (groupe Bolloré) implante une gigafactory dédiée aux batteries solides : 25 GWh/an, 2,2 Md€, 1 500 emplois. Nidec fabrique déjà des moteurs électriques en Alsace, et Daimler Buses s’installe dans la Meuse pour une ligne d’autobus électriques. La boucle locale se referme.
Et pour le recyclage ? Direction Amnéville, sur le site de Cedilor (Veolia/SARP Industries), qui vise 20 000 tonnes de batteries lithium-ion retraitées/an. Le projet LiFE, coordonné par GeoLith à Haguenau, explore le vieillissement des matériaux extraits par géothermie pour optimiser leur recyclabilité. La réglementation européenne impose dès 2030 un taux minimal de matériaux recyclés dans les batteries neuves : une contrainte ? Non, une opportunité industrielle.
🏛️ Argent, régulation, recherche : les trois leviers invisibles
Le financement est massif : État (via ADEME et Bpifrance), Région Grand Est (stratégie hydrogène 2020-2030), Europe (Horizon Europe, Innovation Fund, Interreg). En 2021, l’ADEME Grand Est (Metz, Strasbourg, Châlons) a soutenu 600 projets pour 89 M€. Mais la CRE appelle à la vigilance : pas de subvention croisée entre filières, un soutien ciblé d’abord vers les usages industriels (hubs locaux), ensuite vers les infrastructures nationales (s’il y a mutualisation).
Les universités de Lorraine et Strasbourg alimentent l’écosystème avec une cinquantaine de chercheurs spécialisés (batteries, électrolyse, métaux critiques). L’héritage sidérurgique et chimique de la région se transforme en base de compétences précieuses pour les filières émergentes. Le plus précieux des métaux ? Le savoir-faire.
🚀 Conclusion : un point d’inflexion stratégique, à suivre de près
L’Alsace-Moselle ne se contente plus de faire partie du paysage : elle s’impose comme un laboratoire géopolitique, technologique et économique de la transition. Rarement une région aura réussi à articuler autant d’acteurs, de filières et de dynamiques autour d’un objectif aussi clair : souveraineté énergétique et réindustrialisation verte.
Les défis restent immenses : viabilité économique, acceptabilité sociale, montée en puissance industrielle. Mais la logique systémique est en marche : on extrait, on transforme, on transporte, on recycle — souvent dans un rayon de quelques dizaines de kilomètres. À l’heure où la transition énergétique cherche ses terrains d’ancrage, l’Alsace-Moselle incarne une version crédible, même si encore incomplète, de cette mutation. Un hub ? Oui. Une vitrine ? Aussi. Mais peut-être surtout : un vrai moteur.
🔗 Pour aller plus loin
- L’Union européenne soutient trois projets hydrogène dans le Grand Est
- Le projet de lithium géothermal d’Eramet en Alsace
- Cartographie de la filière lithium en Alsace – Rue89 Strasbourg
- Un réseau thermique transfrontalier entre Kehl et Strasbourg – Le Monde de l’Énergie
- Stratégie hydrogène du Grand Est (PDF officiel)